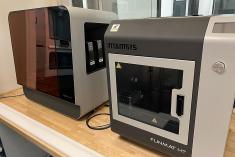La réalisation de projets en collaboration avec les premières nations offre son lot de défis et d’opportunités. Quelles sont les clés pour mieux travailler ensemble ?
LFG Construction est en plein essor, ayant presque doublé son chiffre d’affaires au cours des deux dernières années. L’entrepreneur général doit cette forte croissance en partie grâce au retour du secteur de l’éolien, mais aussi à sa capacité de tisser des liens serrés et fructueux avec les Premières Nations.
« C’est un secret! » lance à la blague Guillaume Lapointe, directeur du bâtiment et co-actionnaire de LFG Construction, quand on lui demande quels seraient ses conseils pour un entrepreneur qui souhaite collaborer avec les Premières Nations.
N’empêche que derrière cette boutade se cache une grande vérité : on ne peut pas débarquer du jour au lendemain dans une communauté autochtone et espérer tisser des liens d’affaires sur une simple poignée de main. Pour nouer des relations solides, il faut une bonne communication, de la transparence et de l’ouverture d’esprit, mais le jeu en vaut la chandelle.
« Chez LFG, c’est une collaboration que l’on bâtit depuis très longtemps, alors pour nous c’est presque devenu un avantage concurrentiel, tellement c’est dans notre culture », ajoute Guillaume Lapointe.
Son collègue Benoît Dubé, également actionnaire et directeur du bureau de Sept-Îles, renchérit d’entrée de jeu en énumérant les principales nations et communautés avec lesquelles LFG transige : les Micmacs, notamment la communauté Gesgapegiag, près de la municipalité de Maria ; les Innus de la Basse-Côte-Nord et leurs communautés bordant la rive nord du fleuve Saint-Laurent ; ainsi que les Naskapis, dont le seul village, Kawawachikamach, est situé à environ 15 kilomètres de Schefferville.
Les partenariats avec les communautés autochtones prennent diverses formes : parfois, l’entreprise embauche des employés locaux pour des projets spécifiques, et d’autres fois, elle travaille en tant que partenaire sur des projets initiés par les communautés elles-mêmes. En Basse-Côte-Nord, par exemple, des projets sont menés en partenariat avec des entrepreneurs autochtones, chacun apportant ses compétences et son expertise. LFG Construction fait notamment partie du consortium qui réalise le parc éolien Apuiat, près de Port-Cartier, dans lequel huit communautés innues sont actionnaires.
Avant de commencer une collaboration, les dirigeants de l’entreprise prennent le temps de s’asseoir avec les responsables de chaque communauté afin de bien cerner leurs attentes. Cette étape permet d’établir des bases claires en termes de respect, de communication et d’objectifs pour le projet, en veillant à respecter les besoins et les priorités spécifiques de chaque communauté.
Une cohabitation de longue date
Fondée en 1975, à Carleton-sur-Mer, LFG est présente sur la Côte-Nord, en Gaspésie, dans le Nord-du-Québec et au Nouveau-Brunswick, principalement dans les secteurs industriels, commercial et institutionnel.
L’entreprise évolue donc depuis toujours sur un territoire fortement occupé par des communautés autochtones. S’en faire des alliées est bien sûr un gage de pérennité pour l’entreprise, mais ses motivations vont maintenant plus loin que l’aspect stratégique et ses dirigeants en tirent une grande fierté. « Avec le temps, nous avons développé de vraies amitiés et nos relations se déroulent dans le plaisir. Nos employés ont du fun sur les chantiers : ils partagent des expériences et des traditions avec eux », souligne Guillaume Lapointe.
Les projets avec les communautés autochtones comportent des ajustements concrets, qu’il s’agisse de l’aménagement des horaires de travail, notamment lors des périodes de chasse, de dons ou de l’intégration d’employés locaux. L’entreprise est aussi souvent sollicitée pour contribuer à des initiatives communautaires.
S’adapter aux différentes cultures
Il n’y a pas une, mais des cultures autochtones, répèteront sou- vent les deux hommes. « Il faut respecter ces différences et s’adapter, dit Benoît Dubé. Pour les Innus, par exemple, le plus important ce sont les retombées. Est-ce qu’on maximise les emplois dans la communauté ? Est-ce qu’on fait appel à des entre- preneurs innus ? Ce sont des questions qu’on se fait tout le temps poser », précise le directeur.
Et pour travailler avec les Micmacs, ajoute Guillaume Lapointe, il faut parler anglais. Les bâtiments et projets réalisés dans les communautés autochtones se distinguent souvent par un design unique et un souci esthétique plus prononcé, qui peuvent rappeler une certaine connexion avec la nature, remarquent les deux directeurs.
« Les bâtiments sont rarement carrés ou standards, dit Benoît Dubé. Ils intègrent des éléments esthétiques comme le bois lamellé-collé, avec des formes arrondies. » Cette ouverture vers des conceptions architecturales originales représente un atout pour l’entreprise, qui voit dans ces projets l’opportunité d’innover et de diversifier ses compétences.
Parmi les projets récents qu’elle a réalisés et qui portent cette marque d’originalité, il y a le Turtle Lodge, dans la municipalité de Pointe-à-la-Croix. Inspiré de la forme d’un tipi, le bâtiment se distingue comme un exemple de cette architecture singulière. D’autres projets, comme des postes de police et des centres communautaires réalisés en territoire autochtone, s’illustrent par leur originalité et la beauté de leurs finitions. « Ces éléments sont rarement présents dans des constructions publiques classiques. Ça nous donne la chance de travailler sur des infrastructures qu’on ne voit pas dans d’autres projets », dit Benoît Dubé.
Le directeur est fier d’avoir un environnement de travail où la diversité est valorisée. Elle est perçue comme un modèle d’ouverture. « Quand une femme gradue dans un métier de l’industrie, la première compagnie à qui on pense pour la référer, c’est souvent nous », remarque Benoît Dubé. Ce type d’inclusivité joue un rôle clé dans le succès de la collaboration avec les Premières Nations, car il renforce le respect mutuel et permet aux travailleurs de s’intégrer plus facilement.
Cet article est tiré du Magazine – Les Leaders de la construction 2024. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !
Ce sujet pique votre curiosité ? Lisez tous les articles du dossier LES LEADERS DE LA CONSTRUCTION 2024 :
- Les Leaders de la construction 2024
- Heures travaillées : les leaders au Québec en 2023
- Les chefs de file des heures travaillées par métier en 2023
- Construire le Montréal de demain : entrevue avec Mélanie Robitaille
- MCF Lab, un projet pour stimuler l’innovation en construction
- La croissance exponentielle de la Ferblanterie Laro DC
- Évoluer dans la continuité: la recette JCB Construction
- Trouver des solutions créatives pour réussir en région éloignée
- Les clés d’une relève réussie
- Comment amener son leadership au prochain niveau ?
- Pénurie de main-d’œuvre : pourquoi recruter à l’étranger s’impose ?
- Un programme RH innovant pour fidéliser et faire grandir ses talents
- Plomberie Charbonneau : 230 ans d’excellence et une vision tournée vers l’avenir